THEMA / L’INTERVIEW : « Les réseaux sociaux agissent comme un amplificateur »
Santé mentale, pression scolaire, réseaux sociaux... Entre accueil physique et présence en ligne, comment accompagner les jeunes d'aujourd'hui ? Rencontre avec Dimitri Aizac et Jean-Claude Bondaz, qui accompagnent des ados et des jeunes en Ardèche.
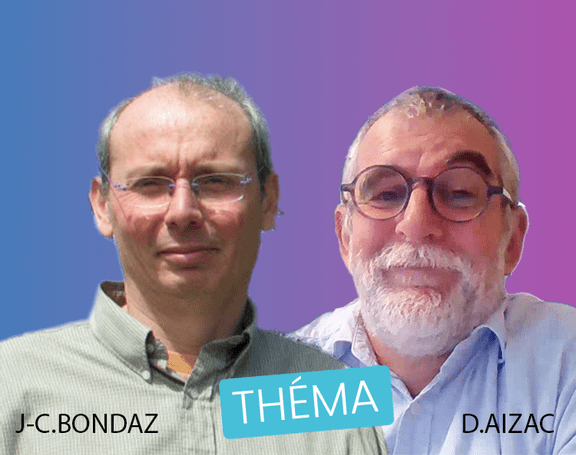
L’adolescence, phase cruciale de développement, est aussi marquée par des tensions intérieures et des défis extérieurs. De la pression scolaire aux préoccupations sur l’avenir, de l’influence des réseaux sociaux aux enjeux de santé mentale, les jeunes d’aujourd’hui naviguent dans un environnement complexe.
Mais comment les aider à surmonter ces obstacles ? Comment allier écoute, soutien psychologique et présence numérique pour soutenir les jeunes et trouver des réponses adaptées à leurs préoccupations ?
ENTRETIEN avec
Dimitri AIZAC et Jean-Claude BONDAZ
Dimitri AIZAC ->> Coordinateur de la Maison des Adolescents d’Annonay (Ardèche)
Jean-Claude BONDAZ ->> Coordinateur des Promeneurs du Net 07 et de Parentalité Numérique 07 (Ardèche)
Quels sont les principaux motifs de mal-être chez les adolescents aujourd’hui ?
Dimitri Aizac
À la Maison des Ados, le premier motif d’accueil, et de très loin, ce sont les troubles liés à l’anxiété, l’angoisse, la tristesse de l’humeur. Cela concerne plus d’un tiers des situations, dans des proportions comparables aux chiffres nationaux.
Viennent ensuite les difficultés scolaires, comme la perte d’intérêt ou la déscolarisation, puis les problèmes de comportement et le harcèlement, qui touchent environ 15 % des jeunes reçus.
Ce qui nous alerte surtout ces derniers mois, c’est l’augmentation très nette des violences subies, en particulier sexuelles, surtout chez les jeunes filles. Depuis 2024, c’est devenu la troisième problématique la plus abordée lors des entretiens, avec une hausse de 83 % des situations déclarées en un an. Cela peut certes s’expliquer en partie par une meilleure visibilité de la maison des ados, via le bouche-à-oreille, notamment, et par une parole qui se libère progressivement. Reste que le constat est alarmant.
Les addictions, en revanche, ne représentent que 3 % des demandes. Mais ce chiffre mérite explications : les jeunes ne perçoivent pas toujours leurs usages (jeux vidéo, réseaux sociaux, produits) comme problématiques mais au contraire comme un réconfort. Les campagnes de culpabilisation des consommateurs actuellement diffusées freinent les déclarations, les ados ont souvent peur d’être jugés ou sanctionnés en parlant de consommations illicites. À mes yeux, c’est une problématique largement sous-déclarée.
Jean-Claude Bondaz
J’ai l’impression que le mal-être fait partie intégrante de l’adolescence. C’est une phase de construction, avec des hauts et des bas. Même un jeune qui va bien peut traverser des périodes de fragilité.
Mais ce qu’on observe surtout, c’est la pression énorme autour de l’orientation scolaire. Et d’autres sources d’angoisse viennent s’y ajouter : les enjeux environnementaux, les conflits mondiaux… Certains nous disent : “De toute façon, la guerre arrive.” Ce climat anxiogène les empêche de vivre leur adolescence avec insouciance, et de se projeter. Au final, ils sont pris dans un enchevêtrement de pressions scolaires, d’inquiétudes globales, d’angoisses relationnelles dans leurs cercles d’amis et de leurs propres turbulences internes.
Vous semblez dire tous deux que la pression scolaire a aujourd’hui un impact important sur la santé mentale des jeunes ?
Jean-Claude Bondaz
Entre Parcoursup et les choix imposés dès la 4e ou la 3e, les jeunes se retrouvent très tôt sous pression. Ce n’est pas tant la faute des parents ou des enseignants, que celle d’un système éducatif structuré de manière à exiger des décisions précoces et souvent anxiogènes.
Dimitri Aizac
La pression scolaire, dont l’orientation, concerne à elle seule environ 5 % des jeunes reçus. C’est aussi une pression liée à l’estime de soi. Beaucoup de jeunes se fixent des objectifs très élevés, parfois plus que ce qu’on attend réellement d’eux. Par peur de l’avenir, ils s’imposent une exigence folle. Pour certains, avoir 11 de moyenne, c’est déjà synonyme d’échec. Ce sentiment est parfois accentué par l’école, la famille, et souvent les jeunes eux-mêmes, entre eux.
Les jeunes parlent-ils facilement de santé mentale ?
Dimitri Aizac
Les jeunes d’aujourd’hui sont plus sensibilisés à la santé mentale que les générations précédentes, ils en parlent plus facilement. Mais il reste des peurs : beaucoup associent encore santé mentale et psychiatrie, avec des questions du type “Est-ce que je suis fou ?”, “Est-ce qu’on va lire dans ma tête ?” Ces représentations sont encore très ancrées.
Un autre frein vient de l’entourage. Les jeunes ont souvent envie d’en parler, mais ils craignent d’inquiéter leurs parents, qui ne sont pas toujours à l’aise avec le sujet. On oublie souvent à quel point les jeunes s’inquiètent pour leurs parents. Enfin, à l’école, un ado qui parle de santé mentale peut vite déclencher une forte inquiétude auprès des équipes éducatives qui vont le surveiller « comme le lait sur le feu ». Même si c’est bienveillant, cela peut renforcer la pression scolaire, leur donner un sentiment de stigmatisation et freiner la parole.
Jean-Claude Bondaz
Les jeunes se confient plus facilement à des animateurs jeunesse ou à des pros qu’ils croisent régulièrement, surtout quand une relation de confiance s’est installée. Les réseaux sociaux peuvent vraiment faciliter ce premier lien. C’est tout l’intérêt des Promeneurs du Net : en étant là, présents, bienveillants, ils ouvrent des portes tout en douceur, derrière un écran, sans que le jeune ait l’impression d’être jugé. C’est souvent plus simple pour les jeunes d’envoyer un message quand ça ne va pas, plutôt que d’en parler en face à face. Mais pour que ça fonctionne, il faut que l’adulte soit visible, qu’on sache qui il est, et qu’il est là sans poser de regard moralisateur.
Les réseaux sociaux sont souvent accusés d’aggraver l’anxiété des jeunes. Comment voyez-vous leur impact, qu’il soit négatif ou positif ?
Dimitri Aizac
Les parents ou l’entourage viennent souvent avec l’idée que c’est « la faute des réseaux sociaux ». Mais le sujet est plus complexe.
Chez les plus jeunes, l’exposition à des contenus violents, sexuels, racistes ou masculinistes pose un vrai problème. Pas forcément sur leur comportement, mais sur leur niveau d’anxiété. C’est particulièrement marqué entre 12 et 15 ans, avec des phénomènes comme le harcèlement numérique ou les « fichas » [1]. Et ce n’est pas seulement la nature de ces contenus toxiques qui pose question, c’est aussi et surtout leur fréquence : parfois, toutes les 3 ou 4 vidéos sur TikTok.
Mais à l’inverse, les réseaux peuvent aussi jouer un rôle positif. Dans des territoires ruraux comme le nôtre, où les jeunes se voient peu en dehors de l’école, les 15-20 ans restent connectés le soir. C’est un moyen de maintenir le lien, de se confier, de ne pas se sentir seul. Ça peut vraiment participer à apaiser l’anxiété.
En réalité, l’impact est très inégal. Un jeune entouré va souvent utiliser les réseaux pour renforcer ses relations. Mais un jeune isolé, déjà fragile, sera plus exposé aux pièges : faux comptes, contenus toxiques… Les réseaux exacerbent les difficultés de la vie réelle.
Et puis, il y a les usages hybrides. Certains jouent en ligne, par exemple sur Fortnite, et discutent avec d’autres via les chats. Parfois, c’est leur seul espace social de la journée. Si ces échanges sont peu bienveillants, cela devient leur seule référence relationnelle. Et à côté, ils passent à côté d’expériences fondamentales de l’adolescence : tomber amoureux, être en colère, prendre le soleil… Tout ce qui nourrit les liens et aide à se construire.
Jean-Claude Bondaz
Les réseaux sociaux ont un impact ambivalent sur les jeunes. Ils peuvent être aussi bien un levier de soutien qu’un facteur aggravant. Pendant le Covid, par exemple, ils ont joué un rôle positif en permettant aux jeunes de maintenir des liens sociaux malgré l’isolement, notamment dans les territoires ruraux où la mobilité est limitée. Pour beaucoup, cela a atténué l’effet anxiogène de la situation.
Quand les jeunes évoluent dans un environnement bienveillant, les réseaux sociaux agissent comme un amplificateur de la sociabilité. À l’inverse, lorsqu’ils sont déjà en souffrance, ces plateformes peuvent renforcer le mal-être. C’est là que doit intervenir la vigilance des adultes, en particulier les professionnels comme les promeneurs du net, dont la présence en ligne permet de capter des signaux faibles et d’ouvrir des portes vers un accompagnement plus structuré.
Les réseaux sociaux permettent aussi aux jeunes en questionnement, sur leur genre, leur orientation ou leur identité, d’accéder à des communautés qu’ils ne trouvent pas localement. Ils favorisent une ouverture, notamment dans les zones rurales où la diversité est moins visible. C’est un outil précieux pour certains jeunes qui se sentent différents.
L’intérêt des réseaux sociaux, c’est aussi l’immédiateté de la relation. Le jeune peut envoyer un message à tout moment, sans avoir à attendre un rendez-vous en présentiel. Pouvoir exprimer, sur l’instant, qu’il vient de se disputer avec ses parents ou qu’il subit du harcèlement ou des violences, c’est essentiel, même si le professionnel n’est pas disponible immédiatement. À l’adolescence, où l’instantanéité a une réelle importance, les situations de mal-être non prises en compte rapidement peuvent finir par s’accumuler.
Enfin, la vitesse des échanges et la culture numérique des jeunes exigent des adultes qu’ils se réactualisent en permanence. Pour établir un lien de confiance, il faut comprendre les codes et respecter l’espace des jeunes, tout en restant présent de manière constante et discrète. Les promeneurs du net, en étant à la fois identifiés et accessibles, créent un lien de confiance qui permet de prévenir ou d’intervenir de manière efficace.
En somme, les réseaux sociaux ne sont pas en soi une source d’anxiété. Leur effet dépend du cadre dans lequel ils sont utilisés et de la capacité des adultes à accompagner les jeunes dans leurs usages.
Qu’est-ce que vous semble vraiment faire du bien aux jeunes aujourd’hui ? Comment les aider ?
Jean-Claude Bondaz
Les jeunes aiment être entre eux, dans des espaces où ils se sentent libres. Ce qui leur fait du bien, c’est justement d’avoir du temps à eux, pour ne rien faire, ou faire ce qu’ils veulent. Et ça, ils en ont de moins en moins.
On leur impose beaucoup de choses : les devoirs, les activités… et en même temps, ils passent beaucoup de temps sur les écrans. Ils le savent eux-mêmes : « ça me prend du temps, parfois j’aimerais faire autre chose ». Il y a un tiraillement entre ce qu’ils aimeraient faire, voir des amis, sortir, bouger par exemple, et ce qu’ils font réellement.
Mais cette impression de « perdre du temps », c’est aussi normal à l’adolescence. On s’est tous construit aussi à travers ces moments d’ennui, de rêverie, de pause.
Ce dont ils ont besoin, c’est donc de liberté, d’autonomie, et d’espaces à eux. Les réseaux sociaux participent parfois à ça : ils s’y sentent plus libres que dans le monde adulte, moins surveillés, moins contrôlés. C’est aussi une autre manière de nourrir leur sociabilité.
Dimitri Aizac
Ce qui fait du bien aux jeunes ? D’abord, d’être avec d’autres jeunes. Être entre amis, dans des cadres cools, festifs, où ils peuvent parler librement. Des endroits à eux, où ils se sentent bien.
Ensuite, c’est que leurs parents aillent le mieux possible. On voit souvent des jeunes venir nous voir, mais en réalité c’est surtout pour qu’on aide leurs parents ! Parce que ceux-ci, parfois ne vont pas bien du tout.
Il est également essentiel que les jeunes passent du temps dehors. Le plein air, l’activité physique, c’est vital, cela joue sur les relations aux autres, le fonctionnement hormonal et du cerveau. En plus, mieux informés que leurs ainés sur la santé mentale, les jeunes adorent comprendre comment ça fonctionne : la dopamine, la sérotonine, le sommeil, le cerveau… Or on ne leur explique jamais ! Et pour les adultes, c’est essentiel aussi de comprendre ça.
Enfin, il faut arrêter de voir les ados uniquement sous l’angle du danger ou du risque. Ce qu’ils attendent de nous, ce n’est pas qu’on s’inquiète pour eux. C’est qu’on les aime. Qu’on se soucie de leur bonheur, de leurs amitiés, de leurs petites folies !
—————————————————————————-
[1] *Les « fichas » sont des publications anonymes ou semi-anonymes (souvent sur Snapchat, Instagram, TikTok) qui exposent publiquement des informations intimes, embarrassantes ou humiliantes sur une personne, souvent sans son consentement.
Propos recueillis par Anne Demotz – Promotion Santé ARA.
Entretien réalisé pour la lettre Interactions Santé, avril 2025.

Les Promeneurs du net de l’Ardèche
Les Promeneurs du Net réunit des professionnels qui assurent une présence éducative en ligne auprès des jeunes, principalement aux 12-18 ans. Porté par la Caisse d’Allocations Familiales, ce dispositif permet aux adolescents de rencontrer des professionnels via les réseaux sociaux, dans un cadre sécurisé et bienveillant : animateurs, éducateurs, professionnels de la santé ou de l’accompagnement.
En Ardèche, on compte 45 promeneurs du Net jeunesse, répartis sur l’ensemble du territoire. À l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes) ils sont plus d’une centaine.
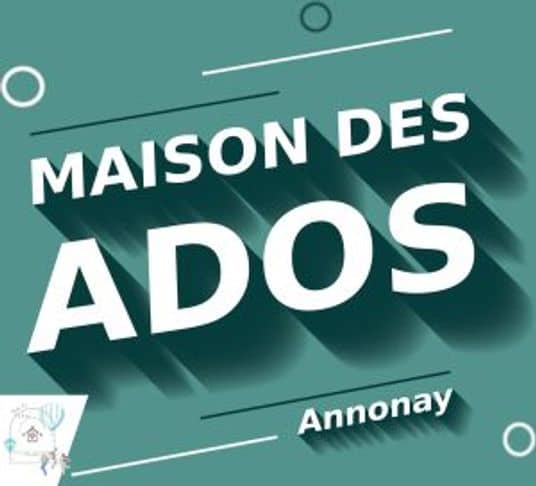
La Maison des Adolescents d’Annonay
Depuis son ouverture en mars 2022, la Maison des Adolescents d’Annonay a accueilli près de 800 jeunes, preuve d’un réel besoin sur le territoire du Nord Ardèche. C’est est un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement pour les jeunes de 12 à 20 ans. On y aborde la santé dans son ensemble : santé physique, sexuelle, affective et mentale. Les jeunes peuvent venir gratuitement, sans rendez-vous, de manière confidentielle, voire anonyme, et sans obligation d’en parler à leur entourage.
Interview réalisée pour la lettre Interactions Santé THEMA – Mai 2025
Voir aussi L’ECLAIRAGE : Comment prendre soin de la santé mentale des adolescents et des jeunes ?